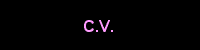PETITE
HISTOIRE DU ROCK
ou
Proposition de compilation parfaite en vingt titres
Tome I : 1977-1982
L'année 1977 est une date charnière qui transforme profondément, et de manière pour le moins radicale, la musique pop-rock. Pourtant, loin de la fureur des nouveaux-nés Sex Pistols, Clash, Damned ou Buzzcocks, l'album majeur de cette période est l'oeuvre d'un groupe profondément ancré dans les années 70. Le Marquee moon de Television nous englue de longues nappes d'un psychédélisme moite et tendu (Torn curtain). J'ai toujours préféré au légendaire Never mind the bullocks le premier album des Clash, dont est extrait l'hymne punk Janie Jones. Au sein de cette mouvance punk, trois groupes se démarquent l'année suivante. Les Buzzcocks prolongent la magie du tubesque Fast cars en assaisonnant leur punk-rock de mélodies incontournables (Ever fallen in love). Au contraire, Crass joue la carte d'une radicalité extrême. Mais au-delà du discours politique indigeste, les pillonnements incessants du méconnu The feeding of the 5000 ont finalement eu raison de ma résistance. Le titre Shaved women, daté de 1979, est une sorte de versant intérieur de cette violence. On est bien loin de cette radicalité avec les Undertones, qui cotoient les sommets du punk-rock et de la pop la plus directe le temps d'un Teenage kicks entêtant. Mais les années 78-79 ne peuvent se limiter à cette mouvance punk. Profitant de ce climat d'effervescence, de nombreux groupes s'épanouissent dans l'ombre de hurlements de plus en plus éraillés. En 1978, Devo signe un album inventif et ludique (Q: Are we not men R: We are Devo) dont est tiré le classique Mongoloid. Les Stranglers ne parviendront jamais à retrouver l'équilibre subtil de The raven et de titres comme Baroque bordello. Les Clash poursuivent leur construction essentielle (London calling), tandis que Wire, dans la lignée des Buzzcocks, s'éloignent du survitaminé 1,2,X U de leurs débuts avec le toujours secret 154, dont est extrait On returning. En 1979 trois autres tubes post-punk envahissent les platines : Planet claire des B-52's, Human fly des Cramps et le magnifique Part time punks syncopé des Television personalities.L'année 1980 marque un autre tournant avec la naissance de deux chefs d'oeuvre absolus estampillés hâtivement cold-wave : le Closer de Joy Division et le Seventeen seconds des Cure. La meilleure chanson des Cure restera sans doute la sombre et angoissante A forest, tandis que la voix de Ian Curtis atteint des sommets d'émotion sur The eternal. Egérie de cette new-wave profonde, Siouxsie sort avec ses fidèles Banshees son meilleur album avec Kaleidoscope (Trophy). Plus proche de groupes électroniques allemands, Killing Joke sort un premier album éponyme qui allie la new-wave la plus sombre et des rythmes proches des rythmes industriels (The wait). Mais cette noirceur deviendra de plus en plus factice, tournée en ridicule par la plupart des groupes de rock gothique tout au long des années 80. Certains parviennent néanmoins à sortir du lot, comme les Cocteau Twins avec Blind dumb deaf ou Bauhaus avec une série de singles entre 1981 et 1983, dont Passion of lovers. D'autres usent et abusent des claviers électroniques pour nous entraîner dans des danses endiablées, comme la danse dite de la mobylette qui consiste à faire semblant de démarrer sa meule en poussant le pied vers le sol de manière répétitive tandis que les bras forment de petits tourniquets, tout cela en tournant sur soi-même et en hurlant Bob Morane contre tous les chacals. Mais derrière ce vernis eighties se cachent quelques instants de plaisir à l'état pur, comme dans les premiers tubes de New Order ou le remuant Another word (1982) de Talk Talk.Mais le début des années 80 ne se limite pas à cette invasion new-wave avec cheveux hirsutes, hurlements d'outre-tombe et peinture noire sous les yeux. La pop-musique se débarrasse peu à peu des tonalités punk pour retrouver une innocence faussement juvénile depuis l'inaltérable Karen des Go-Betweens en 1978. Citons par exemple l'insolente innovation des Feelies avec Loveless love (1980), la douce pop du One by one des Comateens ou encore les envolées pop-folk du magnifique Turning Class (1982) du Monochrome Set.

©2001